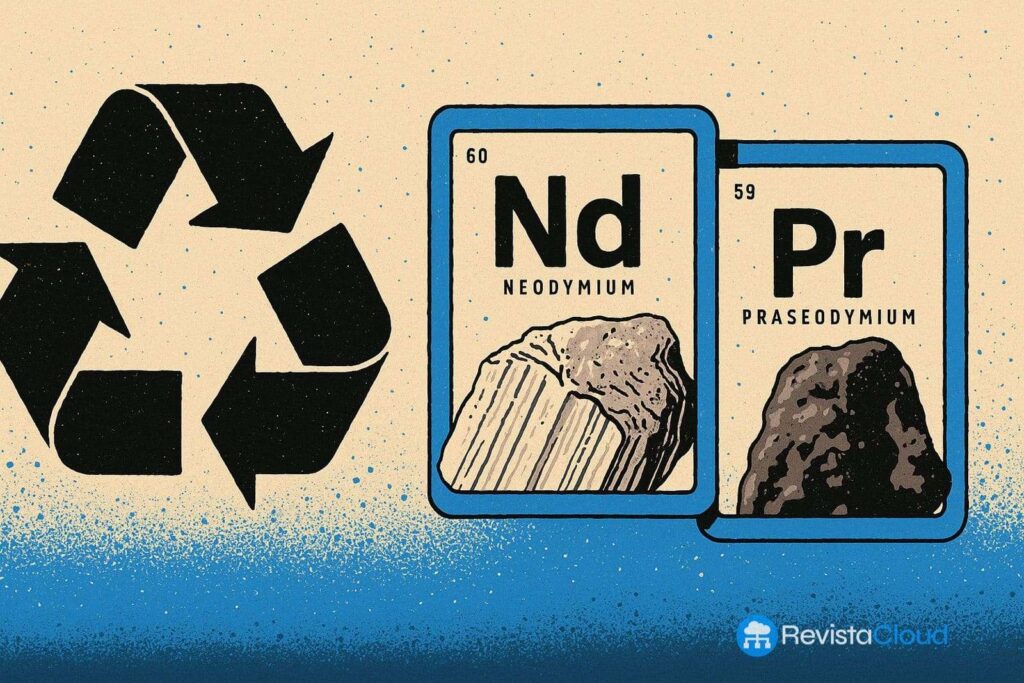L’Inde rêve depuis des années de devenir une puissance mondiale dans le domaine des semi-conducteurs. Le pays, fortement dépendant des importations pour alimenter ses industries technologiques, a lancé en 2021 la Mission indienne pour les semi-conducteurs (ISM), afin d’attirer des investissements, de développer des usines et de réduire cette dépendance stratégique. Le projet phare est la usine de fabrication de puces de Tata Electronics à Dholera, Gujarat, en partenariat avec la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC).
L’objectif initial était clair : produire les premières plaquettes d’ici la fin 2026. Cependant, le calendrier a été repoussé à la moitié de 2027, et selon les experts, il pourrait encore être reporté. La raison principale réside dans la crise mondiale des terres rares et des minéraux critiques, indispensables à la fabrication de semi-conducteurs.
Un projet de 11 milliards de dollars sous pression
Le projet de Tata Electronics est évalué à 11 milliards de dollars (environ 10,2 milliards d’euros). Il comprend la construction d’une salle blanche de pointe et l’installation de machines spécialisées pour transformer le silicium ultrapure en semi-conducteurs de dernière génération.
Depuis l’annonce en février 2024, les travaux avancent à un rythme soutenu. Selon des sources de l’entreprise, l’infrastructure devrait être prête début 2027, avec des essais pilotes de production programmés pour le premier semestre de cette même année. Cependant, la menace ne vient pas des travaux eux-mêmes, mais du supply de matériaux critiques, tels que néodyme, disprósio, terbio, molybdate ou hafnium, utilisés dans la fabrication d’aimants, lasers, polissage de plaquettes et processus de lithographie.
Le problème réside dans le fait que la chaîne d’approvisionnement en terres rares est largement dominée par la Chine, qui assure plus de 60 % de la production mondiale et du raffinage. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de restrictions commerciales, le risque de ruptures ou de hausses de prix est accru.
Une pièce maîtresse pour l’autosuffisance de l’Inde
Pour New Delhi, ce projet n’est pas un simple mouvement industriel, mais une stratégie de souveraineté technologique. L’Inde souhaite réduire sa dépendance aux importations de puces en provenance de Taïwan, de Corée du Sud et des États-Unis, qui représentent des milliards de dollars chaque année et sont essentielles pour des secteurs tels que :
- Véhicules électriques, où les puces gèrent batteries et systèmes de puissance.
- Défense et aéronautique, nécessitant des semi-conducteurs avancés et de haute fiabilité.
- Télécommunications 5G et 6G, où le matériel constitue la base de la connectivité.
- Électronique grand public, des smartphones aux téléviseurs intelligents.
Le gouvernement indien a inscrit cette ambition dans la politique “Make in India”, visant à faire du pays un centre mondial de fabrication. Mais sans accès garanti aux terres rares et aux minéraux critiques, les plans de Tata risqueraient de rester fragiles.
Pourquoi les terres rares sont-elles si cruciales pour les puces ?
Malgré leur nom, les terres rares ne sont pas si rares dans la croûte terrestre. En revanche, il est rare de trouver des gisements économiquement exploitables et de maîtriser la technologie de raffinage permettant de les transformer en matériaux utilisables pour les hautes technologies.
Dans l’industrie des semi-conducteurs, ces éléments jouent un rôle critique :
- Néodyme et disprósio : aimants permanents utilisés dans les moteurs de précision et la lithographie.
- Terbio : employé dans les lasers à haute efficacité pour le gravage.
- Hafnium et molybdate : indispensables pour les revêtements de plaquettes et la fabrication de transistors à haute densité.
- Poudres de terres rares : utilisées dans les composés de polissage pour obtenir des surfaces de plaquettes avec un minimum de défauts.
Chaque plaquette de silicium requiert dizaines de processus chimiques et physiques qui dépendent de ces matériaux. Sans eux, la production est ralentie, coûteuse ou suspendue.
Les retards accumulés : de 2026 à 2030
Initialement, Tata et PSMC avaient prévu de commencer la production fin 2026. Mais face à la pression sur la chaîne d’approvisionnement, les analystes de Gartner estiment que la plant… ne sera pleinement opérationnelle qu’en 2030.
Dans le scénario optimiste, d’ici la moitié 2027, l’usine pourrait générer environ 500 millions de dollars de revenus annuels pour des puces destinées à la gestion de l’énergie, aux microcontrôleurs et à l’industrie. Dans un scénario plus réaliste, vers 2030, ces revenus pourraient atteindre 1,1 milliard de dollars.
Le défi est considérable, lorsqu’on considère que le chiffre d’affaires global des fondeurs “purs” atteignait 933 milliards de dollars en 2024 selon Gartner. L’Inde, avec Tata en tête, cherche à s’implanter dans cette sphère dominée par TSMC, Samsung, Intel et GlobalFoundries.
La réponse du gouvernement indien
Conscient des risques, le gouvernement a lancé une Mission des minéraux critiques dotée de 1.500 crore de roupies (environ 165 millions d’euros) pour diversifier les fournisseurs et développer des réserves locales. L’objectif est de ne pas dépendre uniquement de la Chine, en explorant des accords avec des pays d’Afrique, d’Australie et d’Amérique latine.
Par ailleurs, l’Inde soutient aussi des projets parallèles de montage, test et emballage de puces (ATMP/OSAT). Micron a déjà ouvert une usine à Sanand, Gujarat, tandis que d’autres sociétés comme CG Power (avec Renesas) et Kaynes avancent également dans cette voie. Cependant, Tata Electronics est la seule fonderie de silicium approuvée dans le cadre de la première phase de l’ISM, ce qui renforce la symbolique de son succès ou de son échec.
Le rôle des partenaires internationaux
Tata ne se lance pas seule. La collaboration avec PSMC de Taïwan lui apporte le savoir-faire et l’expérience que l’Inde ne possède pas encore dans la fabrication de masse de puces. Par ailleurs, l’entreprise a recruté des talents du Japon, de Corée et de Taïwan, en engageant des ingénieurs spécialisés en lithographie, dépôt et empaquetage.
Néanmoins, la dépendance aux matériaux critiques et aux fournisseurs d’équipements spécialisés comme ASML (lithographie), Tokyo Electron (équipements de dépôt) ou Applied Materials demeure majeure. Toute perturbation dans cette chaîne mondiale, que ce soit pour des raisons commerciales ou géopolitiques, pourrait mettre en péril le projet.
Le défi de la compétition dans un marché saturé
Même si Tata parvient à surmonter les défis liés à l’approvisionnement, elle devra faire face à la réalité d’un marché très concurrentiel. TSMC et Samsung détiennent plus de 70 % du marché des puces avancées, avec des décennies d’avance technologique.
La stratégie de Tata semble d’abord cibler la demande intérieure dans les secteurs industriel, de la défense et de l’automobile. Par la suite, et uniquement si la production devient stable, l’entreprise pourrait envisager l’exportation.
Cela signifie que les puces fabriquées à Dholera ne concurrenceront pas immédiatement les processeurs 3 nm d’Apple ou Nvidia, mais plutôt des microcontrôleurs, des puces de gestion d’énergie et des solutions de niche. Cependant, dans un monde où la souveraineté technologique devient un enjeu central, cette base pourrait servir de tremplin pour le prochain saut.
Une course contre la montre
Le temps presse et le défi est double : construire une usine de haute complexité et garantir un approvisionnement stable en matériaux critiques. La raréfaction des terres rares ne se limite pas à en faire augmenter les coûts, elle risque aussi de retarder la date à laquelle l’Inde pourra fêter sa première grande fonderie de puces.
La conjonction est évidente : l’Inde peut disposer de l’infrastructure, mais sans matériaux, la production ne pourra pas démarrer. Et dans un secteur où chaque mois de retard peut entraîner la perte de contrats multimillionnaires, le risque est considérable.
Conclusion : l’avenir du silicium indien dépend de la géopolitique
La fonderie de Tata à Gujarat symbolise l’ambition indienne de prendre le train des semi-conducteurs. Mais ce projet reflète aussi les vulnérabilités globales de la chaîne d’approvisionnement technologique, où un petit nombre de pays contrôle des intrants clé pour l’industrie.
La réussite ou l’échec de cette usine aura un impact non seulement sur Tata Electronics, mais aussi sur la crédibilité de l’Inde comme puissance émergente dans le domaine des puces. Si le pays parvient à sécuriser les terres rares et à augmenter sa production, il fera un bond historique. Dans le cas contraire, il risque de se retrouver piégé dans un labyrinthe de retards, de coûts croissants et de dépendance extérieure.
Questions fréquentes (FAQ)
1. Qu’est-ce que l’usine de Tata Electronics à Dholera, Gujarat ?
C’est la première fonderie de semi-conducteurs autorisée dans le cadre de la Mission indienne pour les semi-conducteurs. Son coût estimé est de 11 milliards de dollars, avec une mise en service prévue pour la moitié de 2027.
2. Pourquoi les terres rares sont-elles cruciales pour la fabrication de puces ?
Des éléments comme néodyme, disprósio, terbio ou hafnium sont utilisés dans la fabrication d’aimants, lasers, polissage de plaquettes et transistors. Sans eux, la production de semi-conducteurs s’arrête ou devient beaucoup plus coûteuse.
3. Quels sont les risques pour l’Inde avec ce projet ?
Le principal danger réside dans la dépendance à la Chine pour l’approvisionnement en terres rares, ce qui pourrait retarder la production ou en faire grimper les coûts. La compétition mondiale et le manque d’expérience locale dans la filière constituent également des enjeux importants.
4. Quel rôle joue le gouvernement indien dans ce projet ?
Le gouvernement a lancé une Mission des minéraux critiques avec 1.500 crore de roupies, avec des incitations fiscales et des accords internationaux pour diversifier les sources d’approvisionnement. Il soutient aussi des projets de montage, test et emballage de puces (ATMP/OSAT). La fonderie de Tata reste la seule autorisée dans la première phase de l’ISM, soulignant son importance stratégique.
via : communicationstoday