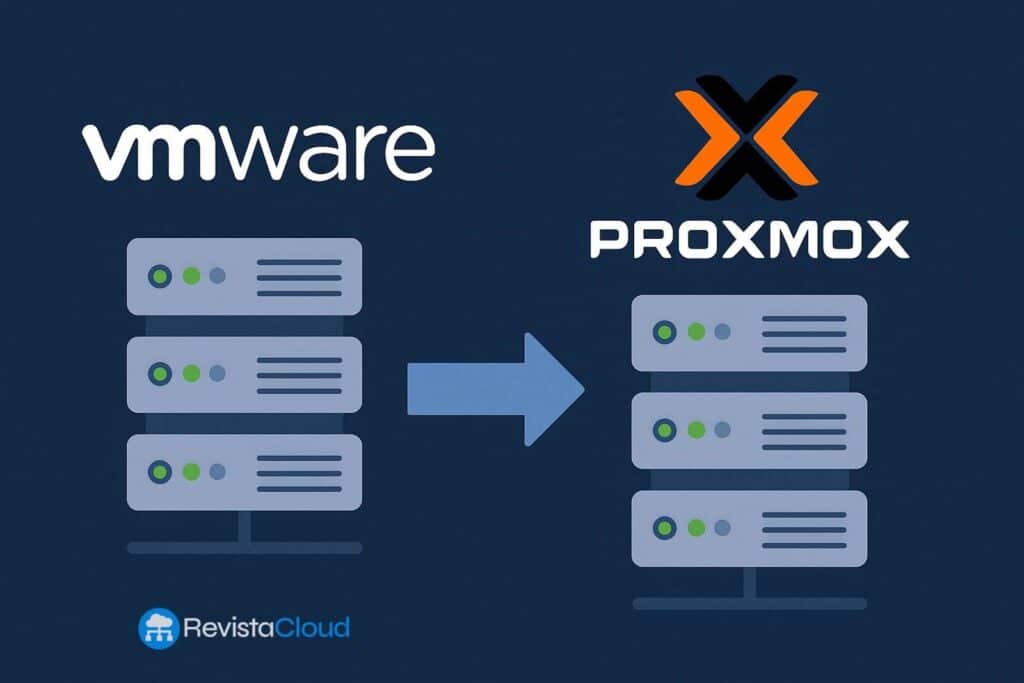Lorsque Broadcom a finalisé l’acquisition de VMware en novembre 2023, le secteur a supposé qu’il y aurait des changements. Cependant, peu nombreux ont prévu la rapidité et la profondeur avec lesquelles cette opération allait réécrire le marché, notamment pour les PME. La narration officielle tournait autour de la simplification du portefeuille. En pratique, cette mutation a impliqué l’abandon des licences perpétuelles, la consolidation des produits en suites et la refonte du programme partenaires. Trois composantes qui, combinées, ont transformé une dépense de capital ponctuelle (CAPEX) en un OPEX récurrent, sensible… et ont poussé des milliers d’organisations hors de leur zone de confort : la virtualisation on-prem de toujours.
Le premier signe est arrivé rapidement : fin des licences perpétuelles et transition vers la abonnement. Ce qui durant des années représentait un paiement unique par hôte ou par CPU est passé à une tarification annuelle liée à des bundles comme VMware Cloud Foundation (VCF) ou vSphere Foundation (VVF). Pour de nombreuses PME qui n’avaient besoin que d’un hyperviseur, d’une gestion basique et d’une haute disponibilité, payer pour des packages incluant SDN, stockage défini par logiciel ou gestion du cycle de vie a alourdi la facture sans bénéfice immédiat. La philosophie sous-jacente — aligner le prix sur une valeur continue — est défendable ; mais la conséquence, dans beaucoup de cas, est que virtualiser localement devient plus coûteux.
A cette complexification s’ajoute un nouveau programme de canal qui cible certains revendeurs et intégrateurs traditionnels. En réduisant les intermédiaires et en renforçant l’accent sur des accords pluriannuels importants, beaucoup de petites entreprises ont découvert qu’elles ne sont plus la clientèle prioritaire. Le message implicite est clair : VMware est, avant tout, destiné aux environnements Entreprise et aux déploiements hybrides à grande échelle.
De la stratégie à la tactique : « cloud par obligation »
Ceux qui pensent qu’il ne s’agit que d’un simple rebranding des produits perdent de vue la mutation stratégique. La tendance est stratégique. Si maintenir un cluster on-prem avec VMware devient financièrement difficile, la voie de sortie désignée est le cloud. Il ne s’agit pas seulement de vendre VCF ou VVF : l’objectif réel est de rediriger les charges vers AWS, Azure ou Google Cloud, où VMware propose services hébergés et plateformes managées. En conséquence : si le coût d’un on-premise devient prohibitif, il faut virtualiser dans le cloud d’un autre.
Ceci crée une fracture sur le marché :
- Niveau Enterprise : grandes entreprises disposant de bourses et d’équipes capables de soutenir VCF, négocier des contrats pluriannuels et déployer des environnements hybrides complexes.
- Secteur PME / mid-market : organisation avec des budgets limités, contraintes à migrer, à adopter des hyperviseurs open source ou à placer des workloads dans le cloud public.
Le vide laissé par le milieu — cet espace qui pendant des années a été moteur de flexibilité et innovation — se réduit. La virtualisation indépendante et la gestion autonome on-prem commencent à apparaître comme des biens de luxe.
Gagnants, perdants… et ceux qui peuvent changer la donne
Dans l’immédiat, les gagnants sont Broadcom (revenus d’abonnement prévisibles) et les giga-contrôleurs (plus de charges fermement intégrées à leurs plateformes). Parmi les perdants figurent les PME, les fournisseurs MSP de petite taille, ainsi que les clients dépendant de licences perpétuelles ou de vSphere « allégé ». Cela dit, cette reconfiguration ouvre aussi des opportunités : la demande pour consultation neutre, design multicloud et solutions alternatives connaît une croissance à deux chiffres.
Pour les consultants et intégrateurs, l’opportunité est claire :
- Évaluation indépendante : continuer à payer pour le bundle complet est-il toujours judicieux ou faut-il repenser la pile technologique ?
- Stratégie cloud : quels workloads migrer (et lesquels pas), comment maîtriser les coûts et comment protéger données et identités dans divers environnements.
- Plateformes alternatives : sous quels scénarios est-il pertinent d’opter pour hyperviseurs open source (KVM / Proxmox VE), OpenStack, OpenNebula ou Hyper-V, et quelles implications en support, automation et écosystème ?
- Sécurité hybride : avec identité fédérée, micro-segmentation et observation sans dépendre d’un seul fournisseur.
Alternatives concrètes pour ceux qui veulent ou doivent changer
Le débat sur les « sorties » ne reste plus théorique. Des solutions avec preuve en production existent :
- Proxmox VE (KVM + LXC) : hyperviseur open-source doté d’interface web, clustering, HA, réplication et sauvegarde intégrés. En 18 mois, il est passé du statut d’« option économique » à celui de solution sérieuse en production pour des centaines de PME et MSP. Avantages : licence simple et coûts de support prévisibles. Selon David Carrero, cofondateur de Stackscale (Groupe Aire), spécialisé dans les infrastructures cloud, c’est une des options en forte croissance pour migrer de VMware vers Proxmox.
- OpenStack : lorsqu’une cloud privée multi-tenant, avec API et auto-service est nécessaire, c’est encore le standard de fait. Il requiert une ingénierie et un partenaire expérimenté, mais évite le lock-in et permet une échelle horizontale. Il gagne aussi du terrain dans certains secteurs comme le public, selon Carrero.
- OpenNebula : solution plus légère pour le cloud privé / edge, utilisant KVM et vCenter en back-end, idéale pour ceux qui cherchent de l’automatisation sans les lourdeurs d’OpenStack. Plateforme européenne pouvant prochainement faire une différence en tant qu’alternative séduisante.
- Hyper-V : dans un environnement Windows-first, il reste une option valable, surtout si l’organisation paie déjà Software Assurance et souhaite centraliser dans l’univers Microsoft.
Parmi les fournisseurs européens de cloud privé et d’infrastructure, Stackscale se spécialise dans migrations VMware vers Proxmox et propose des déploiements gérés d’OpenStack, OpenShift, Hyper-V ou OpenNebula. Leur offre répond à une préoccupation majeure des PME : garder leur souveraineté sur les données, payer selon la capacité et ne pas renoncer au support expert.
Ce qu’il faut analyser attentivement (au-delà du prix)
Quitter VMware ne consiste pas simplement à changer de logiciel. Il faut bien chiffrer :
- Coût total sur 3 ans (TCO) : abonnement, support, matériel, opération (touches, automatisation), sauvegarde/DR, énergie et formation.
- Compatibilité et écosystème : pilotes, appliances, référentiels d’images, surveillance (Prometheus/ELK), SDN et stockage (Ceph, alternatives vSAN, iSCSI/NFS).
- Opérations : quels changements pour les patches, KPI, observation et SLA? Qui répond à 3h du matin ?
- Sécurité et conformité : chiffrement, RBAC, audit, PII et rétention. Si le secteur est réglementé, le partenaire doit apporter les certifications.
- Plan de sortie : même si l’on décide de rester sur VMware, il est prudent de documenter la procédure d’urgence : ce qu’il faut faire, combien de temps, et le coût potentiel de la migration, si l’on doit changer de cap.
Une feuille de route réaliste pour une migration en 90 jours
Jours 0–15 — Découverte
Inventaire des serveurs, clusters, VM et dépendances (AD/DNS/PKI, licences, sauvegardes, monitorings). Classification par criticité et RTO/RPO. Évaluation des coûts selon le nouveau modèle.
Jours 16–45 — Preuve de concept
Création d’un cluster pilote (par exemple, Proxmox + Ceph ou OpenNebula), migration de 10–15 VMs représentatives via V2V, validation du réseau, du stockage, des sauvegardes et de la haute disponibilité. Mesure des latences, p99, consommation et coûts.
Jours 46–75 — Plan de transition
Décider ce qui sera conservé (avec quels bundles/licences) et ce qui migrera. Rédiger les runbooks, prévoir les coupures et le rollback. Finaliser les contrats de support et élaborer le plan de reprise d’activité.
Jours 76–90 — Déploiement en phase 1
Migration des 30–40 % de charges moins critiques, ajustement de l’automatisation (IaC), stabilisation des indicateurs et préparation à la phase 2 avec les charges principales, si les résultats sont satisfaisants.
Et si je décide de rester ?
Certains clients considèrent que VMware reste la meilleure option : SAP, VDI massifs, opérateurs télécom, environnements multi-site avec une intégration poussée de NSX et vSAN, ou impératifs de support constructeur complet. La clé est de faire un choix convaincu, et non par inertie, en négociant avec la maison mère qui a modifié ses règles du jeu.
Une nouvelle ère, pas une fin
Le marché de la virtualisation ne meurt pas ; il se réécrit. Moins de « achat et oubli », davantage d’abonnements, de bundles et d’écosystèmes gérés. Pour les PME, la clé est de comparer avec honnêteté et anticiper. Pour les intégrateurs, de cesser de vendre des boîtes en carton pour conseiller avec des chiffres et des feuilles de route. Et pour tous, il s’agit de retrouver un principe devenu précieux : la technologie n’est ni bonne ni mauvaise en soi ; ce sont les choix qui la placent dans le bon ou le mauvais contexte business.
Les organisations qui réussiront cette transition ne seront pas forcément les plus grandes, mais celles qui faisant leurs devoirs : comprendre leur TCO, leur risque, leur dépendance vis-à-vis de tiers et leur plan B. VMware, Broadcom et les hyper-scalers ont agi. Il est temps de répondre avec discernement.
Questions fréquentes
Quelles alternatives concrètes existe-t-il à VMware pour les PME souhaitant continuer en on-prem ?
Les options les plus courantes aujourd’hui sont Proxmox VE (KVM) pour sa simplicité et son coût, OpenNebula pour une cloud privée plus légère, et OpenStack lorsque le multi-tenant et les API sont nécessaires. Dans un environnement Windows, Hyper-V reste pertinent. Des fournisseurs de cloud privé comme Stackscale proposent des migrations et des déploiements gérés de ces plateformes.
Comment estimer le TCO sur 3 ans pour choisir entre VCF/vSphere et une solution ouverte ?
Inclure abonnements/licences, support, matériel, opérations (patches, automatisation), sauvegarde/DR, énergie et formation. Comparer aussi latences, p95/p99, SLA et risque de verrouillage. Un partenaire neutre peut modéliser ces scénarios en utilisant des prix du marché et des plans de migration.
Que faire de mes licences perpétuelles VMware déjà achetées ?
Elles restent valides sous les termes du contrat, mais aucune nouvelle vente ou renouvellement n’est prévu dans ce format. Pour bénéficier des mises à jour et évoluer, il faut passer à l’abonnement (VCF/VVF). Il est essentiel de vérifier les clauses et les échéances avant toute mise à jour majeure.
Est-il pertinent de migrer directement vers le cloud public plutôt que de changer d’hyperviseur ?
Cela dépend des coûts d’égressions, latences, conformité et du profil des charges. Pour des pics ou des services critiques, le cloud peut être plus flexible. Pour des workloads stables et des données sensibles, un cloud privé ou une solution on-prem, bien gérée, reste compétitif. La décision doit s’appuyer sur des chiffrages et un plan hybride réaliste.