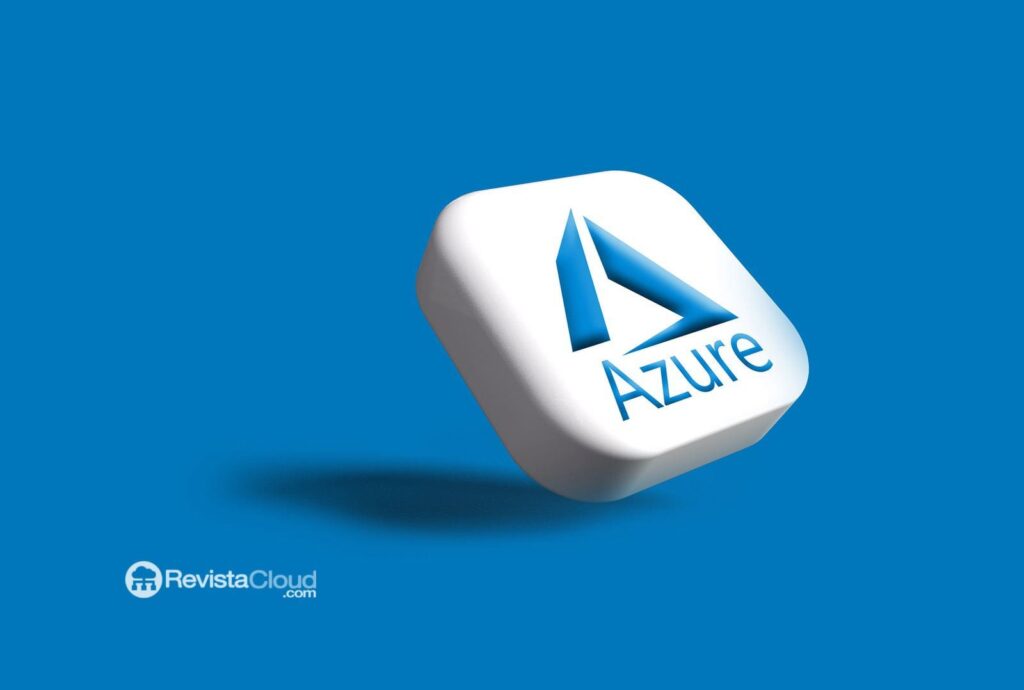Microsoft a annoncé la version bêta de Signing Transparency, un service géré qui met en œuvre le principe du Zero Trust — « ne jamais faire confiance, vérifier toujours » — dans le domaine de la signature de code. Cette initiative vise à pallier une faiblesse bien connue : les signatures valides ont parfois été utilisées pour diffuser des logiciels malveillants lorsque des attaquants ont volé des certificats, compromis la chaîne de construction ou abusé d’une identité de confiance. La réponse consiste à ajouter des preuves publiques et vérifiables à chaque signature, permettant ainsi à toute partie d’auditer ce qui a été signé, quand et selon quelle politique.
Pourquoi la signature de code ne suffit plus
Depuis des années, signer des binaires, des images de conteneurs ou des packages est synonyme de confiance. Mais la signature traditionnelle ne laisse pas de trace auditable autre que celle du certificat lui-même, et ne prévient pas qu’une clé compromise puisse être utilisée à l’insu de tous. Dans ce scénario, la transparence devient la pièce manquante : si chaque événement de signature est inscrit dans un registre immuable, disparaître sans laisser de trace n’est plus une option pour l’attaquant. La sécurité ne dépend plus uniquement de « qui signe », mais aussi de prouves de quand et dans quelles conditions la signature a été effectuée.
Qu’est-ce que Signing Transparency
Microsoft décrit Signing Transparency comme un « notaire neutre » pour la signature de logiciels. À chaque signature d’un artefact — une release d’application, une image OCI, un firmware — le service vérifie la conformité de la signature avec une politique déclarée, la contre-signe et enregistre l’événement dans un registre append-only. En échange, il délivre un reçu cryptographique attestant que cette signature existe dans le registre, avec sa position. Ce reçu peut être archiv é avec l’artefact et validé indépendamment, sans dépendre du fournisseur.
La gestion des clés et l’intégrité du registre reposent sur la computing confidentiel : les clés de service ne quittent jamais l’enclave sécurisée, et le journal n’autorise ni modifications ni suppressions. En cas d’utilisation anormale d’une clé, le traceur est enregistré pour une auditabilité forensique.
Fonctionnement : COSE, contre-signatures et arbres de Merkle
L’implémentation repose sur des coffres COSE (format standard pour signer et empaqueter des métadonnées) et sur le cadre SCITT pour la transparence de la chaîne d’approvisionnement. Le flux est simple :
- Le système de build génère un COSE_Sign1 avec la signature et les métadonnées de l’artefact.
- Cet emballage est envoyé à Signing Transparency, qui vérifie l’identité et la politique associée (qui peut signer, d’où et avec quelles exigences).
- Le service contre-signe l’emballage et l’enregistre dans un arbre de Merkle.
- Il renvoie un reçu avec la preuve d’inclusion (chemin de hachages) et le hached’épine actuel de l’arbre.
La structure de Merkle garantit qu’aucune entrée ne peut être modifiée sans casser les preuves d’inclusion. Les clients peuvent interroger périodiquement la cohérence de l’arbre, stocker des reçus et automatiser les validations dans leurs pipelines CI/CD.
Ce que cela apporte face aux alternatives et ce que cela conserve
Les journaux de transparence ont déjà prouvé leur utilité dans l’écosystème ouvert. La nouveauté ici réside dans un service géré avec des contre-signatures, des reçus portables et un ancrage dans des enclaves destiné aux organisations exigeant une responsabilité cryptographique et une traçabilité avec garanties d’audit. La démarche reste compatible avec les pratiques existantes : elle peut cohabiter avec la signature traditionnelle, les catalogues d’artefacts ou les registres de conteneurs, en ajoutant une couche de vérification indépendante.
Avantages concrets pour le développement, la sécurité et la conformité
- Traçabilité vérifiable. Chaque livraison comprend un reçu indépendant pouvant servir de preuve lors des audits ou analyses forensiques.
- Politiques visibles et appliquées. Il est possible de définir des règles (double signature, fenêtres temporelles, utilisation de HSM/TEE, périmètres repo) et les faire respecter avec une traçabilité publique.
- Détection précoce des anomalies. Les signatures hors norme, identités inattendues ou artefacts non conformes retentissent au monitoring du journal.
- Atténuation des risques de replay et rollback. Les preuves de fraîcheur et de cohérence de l’arbre empêchent la réintroduction de versions anciennes vulnérables.
- Interopérabilité avec les outils d’entreprise. Les reçus peuvent accompagner l’image ou le paquet et être vérifiés localement lors du déploiement, dans les pipelines ou les plateformes de conformité.
Au-delà du logiciel : firmware et matériel
Le même principe — signatures avec transparence vérifiable — s’étend au firmware et aux composants matériels. En s’appuyant sur la confiance enracinée dans la silicium et des mesures de démarrage sécurisé, la transparence ajoute une preuve publique de qui a signé chaque mise à jour, quand et selon quelle politique. L’objectif ultime étant une chaîne d’approvisionnement à l’intégrité vérifiable de bout en bout, du circuit imprimé au runtime.
Ce qui ne résout pas (et pourquoi cela reste essentiel)
Signing Transparency ne remplace pas un SDLC sécurisé ni les bonnes pratiques fondamentales : analyse des dépendances, revue de code, gestion des secrets, segmentation de pipeline ou tests de sécurité restent indispensables. La transparence ne neutralise pas une vulnérabilité si le code est livré propre au moment du build. Elle augmente néanmoins le coût d’un acte furtif et réduit le temps de détection : si un attaquant tente de dissimuler ses traces, il doit soit se cacher dans le log — ce qui est perçu comme une anomalie, soit laisser une trace indélébile qui facilite la réaction.
Comment se préparer à son adoption
- Inventaire des artefacts. Cartographier ce qui est signé (binaires, packages, images, firmware) et qui signe.
- Politique de signature. Définir identités, conditions, co-signatures et contrôles de provenance.
- Gestion des reçus. Déterminer où ils sont stockés, comment ils sont liés aux artefacts, et qui les valide lors du déploiement.
- Automatisation CI/CD. Intégrer la soumission au registre et la vérification des reçus comme étapes obligatoires.
- Surveillance continue. Surveiller la cohérence du registre, les anomalies d’utilisation et les écarts par rapport à la politique.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un reçu cryptographique et à quoi sert-il ?
C’est une preuve portable incluant le hachage racine de l’arbre et le chemin d’inclusion de votre signature dans le registre. Elle permet de démontrer, à tout moment, sans permission du fournisseur, que votre artefact a été signé et enregistré à une date et à une position précises.
Dois-je modifier mes outils de signature ?
Pas forcément. Si vous signez déjà avec des certificats d’entreprise ou via HSM, vous pouvez encapsuler la signature dans un emballage COSE et l’envoyer au service pour obtenir la contre-signerie et le reçu. L’idéal est d’automatiser cette étape dans votre pipeline CI/CD.
Que faire si une clé est compromise ?
Toute utilisation sera enregistrée ; toute signature inattendue ou hors politique pourra être détectée en surveillant le registre. La transparence ne prévient pas l’abus, mais la rend visible, accélérant la réaction (revocation, blocage, rotation).
Comment cela s’intègre-t-il aux audits et cadres réglementaires ?
Les reçus servent de preuves objectives de la gouvernance et du contrôle des releases. Ils facilitent la conformité aux exigences de traçabilité, de non-répudiation et de démarche vérifiable lors des audits.
Est-ce applicable aux conteneurs et aux firmwares ?
Absolument. Tout artefact pouvant être signé — images OCI, packages, binaires, firmware — peut être enregistré pour obtenir une transparence et une preuve d’inclusion, renforçant ainsi l’intégrité de toute la chaîne.
En résumé, Signing Transparency ne vise pas à remplacer la signature de code, mais à la responsabiliser. En combinant contre-signatures, registres immuables et computing confidentiel, elle transforme chaque release en un fait vérifiable, réduit le risque d’attaques silencieuses et élève la confiance et la responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement. Pour les équipes dev et sécurité, c’est une levée concrète permettant de passer du « faire confiance parce que c’est signé » au « faire confiance parce qu’on peut le prouver ».
Sources : azure.microsoft