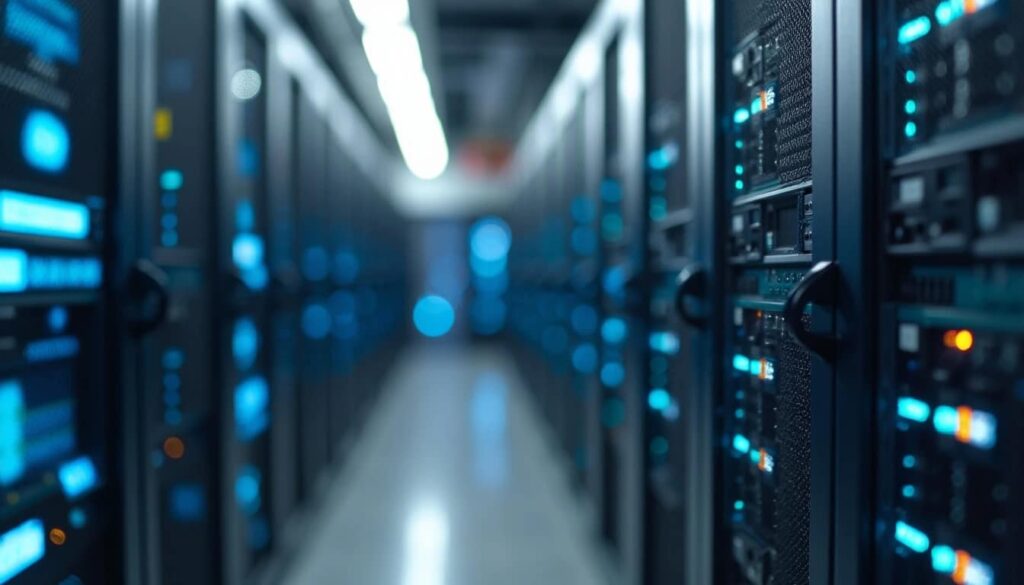Le discours officiel paraît irréfutable : attirer des centres de données, devenir un nœud numérique dans le sud de l’Europe et accélérer le développement de l’intelligence artificielle grâce à des investissements massifs et à une main-d’œuvre qualifiée. Tout cela est vrai. Mais il manque la pièce essentielle : la puissance électrique et le réseau. Sans accès à une énergie disponible au bon endroit et au bon moment, le béton et l’acier ne deviennent que des actifs inutilisés. L’Europe a multiplié les annonces ; il est désormais impératif de connecter les mégawatts. Et l’Espagne, qui ambitionne de devenir un hub, doit passer d’un modèle « build it and they will come » à celui du « wire it and they will run ».
Au niveau continental, la tâche est documentée en détail : la puissance TI des centres de données en Europe devrait passer d’environ 10 GW à près de 35 GW en 2030, et leur consommation électrique dépassera les 150 TWh — représentant environ 5 % de la demande européenne — si l’on considère le scénario de référence. Ce n’est pas une simple nuance, c’est un changement systémique qui oblige à repenser la planification, les permis et le financement des réseaux, ainsi que la production basse en carbone pour leur fournir de l’énergie.
Le miroir européen à ne surtout pas ignorer
Irlande a été pionnière en imposant un frein : le régulateur (CRU) et l’opérateur (EirGrid) ont conditionné les nouvelles connexions à Dublin au fait que les centres de données apportent une génération déployable ou du stockage équivalent à leur demande ; en pratique, cela a conduit à un halt sur les nouvelles mises en service dans la zone métropolitaine jusque 2028. La raison n’était pas idéologique, mais pour garantir la sécurité d’approvisionnement.
Les Pays-Bas ont instauré des moratoires (Amsterdam et Haarlemmermeer) pendant qu’ils définissaient des règles nationales pour les hyperéchelles; aujourd’hui, ils maintiennent des restrictions dans des zones sensibles. L’Allemagne, quant à elle, a choisi une approche conditionnelle : sa Loi sur l’efficacité énergétique (EnEfG) oblige à réutiliser la chaleur (seuil de ERF 10 % en 2026, 15 % en 2027, 20 % en 2028) et à rendre compte de métriques opérationnelles, en conformité avec la Directive européenne sur l’efficacité énergétique (EED), qui instaure déjà une base de données de performance et de empreinte hydrique pour les centres de données. Trois modèles, un message : sans réseau, sans flexibilité et sans règles, il n’y a pas de déploiement durable.
L’Espagne : le hub se joue à la sous-station (pas dans le communiqué de presse)
L’Espagne dispose de avantages évidents — renouvelables compétitifs, position géographique stratégique et câbles sous-marins —, mais se heurte à ses réseaux. À Madrid et Barcelone, les analyses sectorielles soulignent un stagnation due à la saturation des nœuds et à un ralenti pour les nouvelles raccordements, qui pousse les projets vers l’Aragon, la Communauté valencienne, la Cantabrie ou l’Estrémadure. En sept mois, le pipeline national a augmenté de 20 %, mais le frein demeure : puissance signée et délais de raccordement.
La fédération Spain DC l’a dit sans détour : 83 à 85 % du réseau est saturé pour accueillir de nouvelles demandes, et un plan d’investissement dans le transport et la distribution est urgent si l’on veut éviter une fuite des investissements. Le secteur estime un potentiel de 58 milliards d’euros pour l’Espagne cette décennie… à condition que le réseau soit renforcé. Par ailleurs, la consommation du secteur pourrait tripler à environ 730 MW en 2026 contre un peu plus de 200 MW en 2024, mais cette progression ne concorde pas avec le délai de raccordement des sous-stations et lignes si celle-ci n’est pas priorisée.
Le black-out espagnol du 28 avril (avec des coupures prolongées en Espagne et au Portugal) a rappelé une réalité : la résilience du réseau a ses limites, et la flexibilité — stockage, gestion de la demande, services d’inertie — n’est pas optionnelle. Développer des fermes de GPU sans un écosystème électrique complet qui les soutient, c’est s’exposer à un double risque : celui de l’opération et celui de la perception sociale.
Un plan « power-first » pour ne pas manquer la vague de l’IA
Le message de cet article est clair : moins d’inaugurations et plus de connexions. Il ne s’agit pas de freiner les centres de données, mais d’organiser leur déploiement pour qu’ils démarrent dans les temps, avec une énergie faible en carbone, une stabilité du système et une licence sociale. Voici six propositions concrètes :
- Planification électrique avec un corridor prioritaire “digital-crítico”. La Planification 2021–2026 du réseau de transport prévoit déjà des renforcements, et le Gouvernement a validé des modifications ponctuelles ainsi que des investissements supplémentaires. Il faut identifier les actions permettant d’émerger des nœuds numériques (400 kV quand c’est pertinent, mêlés et réactances) et s’assurer d’une date précise. Parallèlement, il faut ouvrir le processus 2025–2030 avec un cartographie publique de la capacité pour des charges >10–50 MW.
- “Cap auctions” pour les grosses charges. Mettre en concurrence la capacité de réseau signée avec des obligations de flexibilité : BESS de 2 à 4 heures, réponse à la demande et coupures contractuelles lors des pics. L’Irlande impose déjà des générations ou stockage équivalents comme condition d’accès, la Spain peut adapter ce modèle sans le copier.
- Approvisionnement vert véritable. Les PPAs sont utiles, mais insuffisants si le réseau ne suit pas. Il faut exiger des grands projets un proof of firming : batteries, contrats de capacité et services stabilisateurs pour apporter inertie et tension maîtrisée. La flexibilité réclamée par le Parlement européen doit se concrétiser dans les cahiers des charges et permis.
- Réutilisation de la chaleur et de l’eau dès la conception. S’inspirer de l’EnEfG allemande : récupérer la chaleur dans les nouveaux centres, avec des objectifs croissants et transparents ; et exercer une transparence hydrique via la base de données européenne de l’EED. La acceptation sociale augmente quand la chaleur sert à chauffer des quartiers, et que l’empreinte hydrique est atténuée par le free-cooling, le contrôle adiabatique ou la refroidissement liquide.
- Politique industrielle pour le transformateur. Le véritable goulot d’étranglement ne concerne pas seulement les mégawatts, mais aussi les transformateurs et équipements de haute et moyenne tension. Un programme de capacité pour produire localement — via des achats publics et des financements innovants — renforcerait la résilience déjà en place.
- Une plateforme unique avec des métriques publiques. Le calendrier, les MW signés, le taux d’avancement des sous-stations et les délais de raccordement doivent être accessibles aux promoteurs et au grand public. Moins de marketing et plus de planification précise : chaque annonce devrait venir avec une “date de mise sous tension” promise par le gestionnaire de réseau et la distribution concernée.
L’Europe a besoin de moins de coups médiatiques, mais davantage de coordination
Bruxelles a agi avec la Directive EED (reporting obligatoire et base de données), mais la véritable responsabilité incombe aux États et à leurs opérateurs de réseau. Si chaque région bloque ou improvise, ce seront ceux qui offriront la certitude électrique qui en sortira gagnant : nœuds opérationnels, règles claires et plateforme unique. La vraie question n’est pas si les data centers existeront ; ils existeront. La question est : où se brancheront en premier.
Pour l’Espagne, l’opportunité est tangible : des études indépendantes projettent un triplement de la capacité installée d’ici 2026 et une avancée de dizaines de TWh en demande européenne d’ici 2030. Mais l’inertie administrative et la saturation des nœuds risquent de déplacer les investissements vers d’autres hubs de la péninsule ou hors du pays. Si l’économie du XXIe siècle se joue en termes de calcul et d’interconnexion, il ne suffit pas de parler d’IA ; il faut aussi l’alimenter. Littéralement.
Le verdict est clair : annoncer des dizaines de centres de données sans puissance signée relève du marketing, pas de la politique industrielle. À ce stade, le seul titre pertinent n’est pas « nouveau campus de X MW », mais « sous-station energisée à telle date, MW disponibles, contrats de flexibilité signés ». Si l’Espagne veut devenir le hub numérique du sud de l’Europe, qu’elle le prouve avec son réseau. Parce que sans réseau, il n’y a pas de nuage.