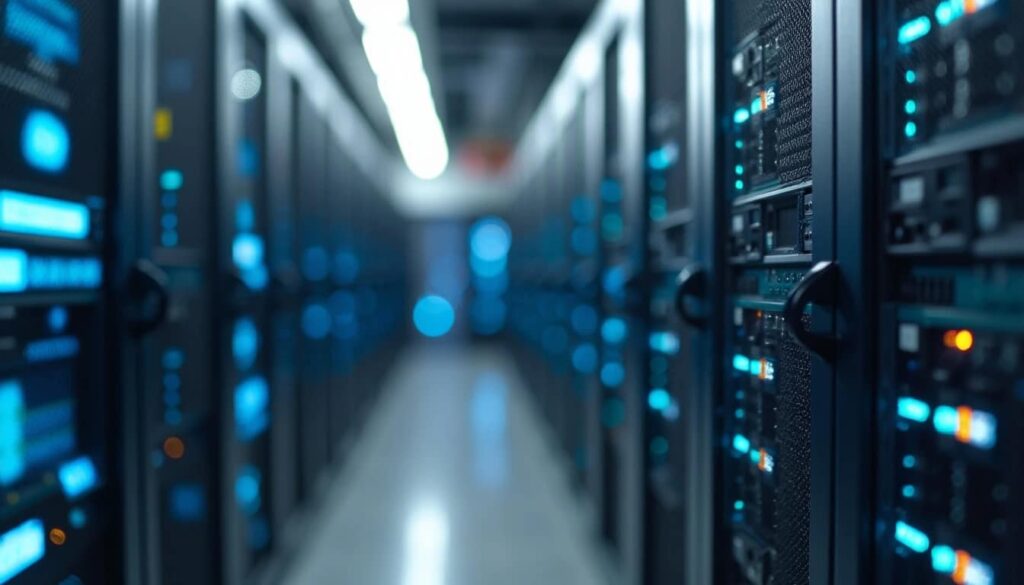L’essor de l’intelligence artificielle et du cloud computing entraîne une flambée sans précédent des prix des terrains destinés aux centres de données. La France, l’Espagne, mais aussi d’autres régions comme l’Allemagne ou la Scandinavie, se positionnent désormais dans ce contexte mondial où la course à la maîtrise de l’infrastructure numérique s’intensifie.
Au second semestre 2025, le marché mondial des terrains pour centres de données connaît une véritable crise de croissance. Les coûts atteignent des sommets, transformant ces terrains, autrefois considérés comme de simples actifs industriels, en une véritable monnaie d’échange pour accompagner la croissance digitale. Les géants technologiques —AWS, Microsoft, Google, Oracle ou Meta— rivalisent d’ardeur pour sécuriser des emplacements stratégiques offrant un accès immédiat à l’énergie et à la connectivité, en réponse à une demande croissante en puissance de calcul pour l’intelligence artificielle, le gaming ou encore les services financiers.
L’Espagne ne reste pas à l’écart de cette tendance. Madrid et ses environs, notamment des zones comme San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares ou Getafe, voient leurs prix du foncier logistique exploser sous l’intérêt des grands investisseurs et des entreprises technologiques. Barcelone, Valence ou encore des secteurs proches de Zaragoza gagnent également en attractivité grâce à leur connectivité accrue, leurs coûts compétitifs et leurs avancées en matière de permis environnementaux.
Selon les professionnels du secteur, le prix du mètre carré pour les projets de centres de données dans certaines zones de Madrid a augmenté de plus de 35 % en un an, tandis que la disponibilité de terrains avec accès à des sous-stations électriques a chuté de manière drastique. Ce phénomène s’observe aussi en Allemagne, aux États-Unis, à Singapour ou encore en Malaisie.
Une nouvelle contrainte majeure apparaît : la disponibilité en énergie, permis d’urbanisme et fibre optique dominent désormais l’évaluation des terrains. Au sein des régions où le réseau électrique est mis à rude épreuve —comme Frankfurt ou la Virginie du Nord—, les terrains proches des sous-stations ou des parcs solaires ou hydroélectriques se négocient jusqu’à quatre fois plus cher qu’il y a dix-huit mois.
Les acteurs privilégient désormais les zones avec des processus d’obtention de permis rapides, un accès à l’eau pour le refroidissement et une connectivité directe à des réseaux de fibre optique ou des points d’interconnexion. Les marchés nordiques, notamment la Suède, la Finlande ou la Norvège, séduit également par leur durabilité et leur performance énergétique.
En Europe, Madrid se positionne comme le principal hub de données dans le sud du continent, rivalisant avec Dublin, Paris ou Amsterdam. La législation favorable, le climat, l’accès aux câbles sous-marins et le coût de l’énergie en font une localisation privilégiée. Lisbonne commence également à accueillir des investissements liés au développement de centres de données à destination de l’Amérique latine et de l’Afrique.
Les principales entreprises derrière cette poussée sont les hyperescaleurs comme AWS, Microsoft, Google ou Oracle, qui signent des contrats pluriannuels pour des terrains et de l’énergie, voire avant même de prévoir une capacité de déploiement immédiat. Ces acteurs représentent plus de 60 % des acquisitions mondiales de terrains pour centres de données. Parallèlement, les fonds d’infrastructure et les sociétés de private equity investissent dans des projets “greenfield”, visant à accélérer le développement de nouvelles infrastructures.
Une évolution majeure dans le secteur réside dans la priorité accordée désormais à l’énergie avant le terrain. Il ne s’agit plus simplement d’acquérir un foncier pour y installer un centre, mais d’obtenir en priorité un engagement ferme sur l’approvisionnement électrique, via des contrats d’achat d’énergie renouvelable (PPA) ou des droits d’accès à la réseau électrique. En Espagne, cette tendance se traduit par des partenariats avec des acteurs comme Iberdrola ou Naturgy dans des régions telles que Guadalajara, l’Aragon ou l’Andalousie.
Ce changement impacte aussi bien les promoteurs que les investisseurs et les gouvernements. Pour les premiers, la marge sur le foncier se réduit, mais les ventes rapides après l’obtention des permis compensent cette baisse. Les investisseurs voient dans ces centres de données une classe d’actifs stable, face à une baisse de rendement dans l’immobilier traditionnel. Quant aux gouvernements, ils mettent en avant l’urgence d’accélérer les processus administratifs et d’assurer un approvisionnement électrique propre pour attirer ces investissements stratégiques.
Pour l’avenir, la tendance pour 2025 inclut des zones comme l’Espagne et le Portugal, qui améliorent leurs infrastructures et leur connectivité sous-marine ; le Chili et la Colombie, en tant que portes d’entrée pour le cloud américain en Amérique latine ; ainsi que l’Afrique du Sud et le Nigeria, qui voient émerger des mouvements de terrains liés à la croissance du cloud africain, ou encore la région Asie-Pacifique, où Malaisie, Filipinas et Thaïlande profitent du débordement de Singapour.
En résumé, à la fin de 2025, le contrôle du duo “terrain + énergie” déterminera l’avenir des données. La stratégie d’acquisition de terrains pour centres de données devient une arme géostratégique dans l’ère de l’intelligence artificielle. Avec ses atouts logistiques, énergétiques et réglementaires, l’Espagne s’affirme déjà sur la scène mondiale. La cloud a besoin d’une terre solide, et cette terre n’est plus seulement en vente : elle devient une ressource précieuse, de plus en plus coûteuse.