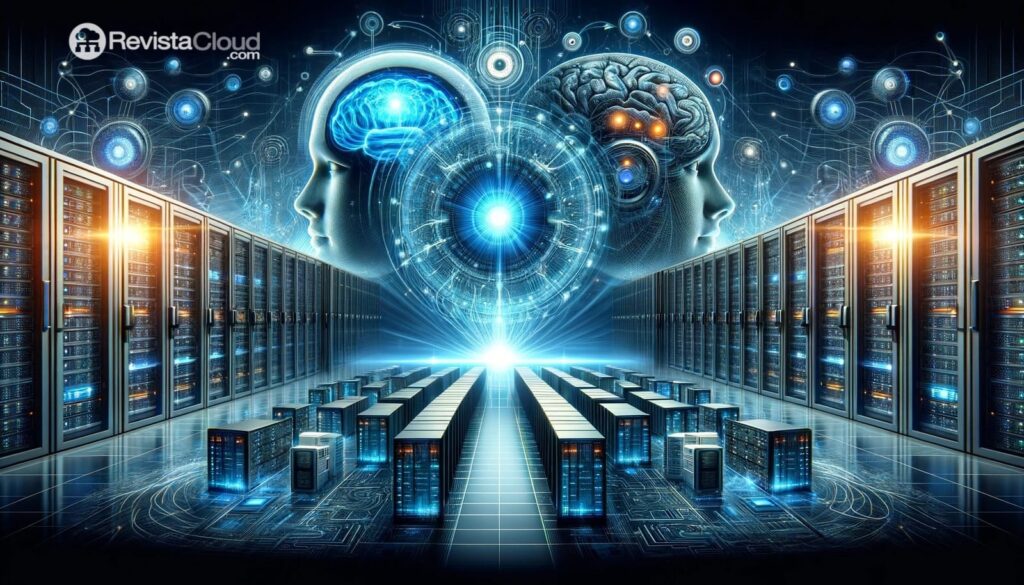Sous l’impulsion de l’intelligence artificielle, un engouement massif pour la construction de centres de données semble évoquer dangereusement les bulles spéculatives des télécommunications dans les années 1990 ou du chemin de fer au XIXe siècle. La croissance du crédit privé et la forte exposition des banques alimentent les inquiétudes quant à un éventuel effondrement financier.
Aux États-Unis, la course effrénée à l’extension des infrastructures liées à l’IA suscite des craintes parmi les économistes. La crainte est que cette expansion, de plus en plus financée par des emprunts et des crédits privés, ne se transforme en une crise comparable à celle de 2008. Selon les données du Wall Street Journal, les sept géants technologiques cotés en bourse, dont Meta, Google, Microsoft et Amazon, ont consacré plus de 1 025 milliards de dollars à des investissements en capital au dernier trimestre, principalement dans des infrastructures liées à l’IA. Chez Microsoft et Meta, ces investissements représentent déjà plus d’un tiers de leurs revenus totaux.
Neil Dutta, analyste en macroéconomie chez Renaissance Macro Research, indique que lors des deux derniers trimestres, les dépenses en capital consacrées à l’IA ont contribué davantage à la croissance du PIB américain que le consommateur privé lui-même.
Historiquement, les investissements massifs dans l’infrastructure technologique ont souvent conduit à des bulles spéculatives suivies de crashes importants. Le chemin de fer au XIXe siècle et la fibre optique dans les années 1990 ont tous deux culminé avec des effondrements économiques après des années de surexploitation du marché et une demande inférieure aux attentes. Bien que ces infrastructures aient fini par bénéficier à la société à long terme, les investisseurs ayant spéculé sur une surcapacité ont presque toujours perdu leurs placements.
Ce qui distingue cette tendance actuelle, c’est le mode de financement. Contrairement à la bulle Internet de 2000, largement soutenue par l’émission d’actions, la fièvre actuelle pour les centres de données repose de plus en plus sur l’endettement, principalement via le marché du crédit privé, souvent appelé « shadow banking » ou financement bancaire de l’ombre.
Les grandes entreprises technologiques, face à des dépenses de capital qui dépassent leur capacité à générer des liquidités, se tournent vers de nouvelles sources de financement. Selon The Economist, des entreprises comme Meta négocient des prêts pouvant atteindre 30 milliards de dollars auprès de géants du crédit privé tels qu’Apollo ou Carlyle. Cependant, ce type de financement non réglementé, rentable en période de croissance, peut devenir un vecteur de risques systémiques si les actifs ne produisent pas les résultats escomptés. Ce risque s’aggrave puisque ces fonds de crédit sont aussi alimentés par des prêts bancaires traditionnels, créant un lien indirect entre le secteur bancaire conventionnel et le boom technologique.
Une récente étude de la Réserve fédérale révèle que la proportion de prêts bancaires américains à des sociétés de crédit privé est passée de 1 % en 2013 à 14 % en 2023. En cas de chute brutale du secteur des centres de données, l’exposition des banques pourrait transformer cette situation en une véritable « bombe financière ».
Les assureurs, notamment dans le domaine de l’assurance-vie, ont également accru leur exposition aux obligations d’entreprises en dessous de la note d’investissement. Une étude de la Fed de Philadelphie montre que ces positions dépassent désormais en volume le montant total des prêts hypothécaires subprime détenus par les assureurs en 2007, juste avant l’éclatement de la crise financière. Le parallèle avec AIG, le géant de l’assurance sauvé lors de la crise de 2008, est sans doute inévitable. Les régulateurs s’inquiètent de plus en plus du transfert opaque des risques du crédit privé à l’ensemble du système financier.
Le marché du crédit privé est décrit comme un « pont dangereux » par l’investisseur et analyste Paul Kedrosky, qui souligne que l’essor de l’IA a dépassé – en termes d’investissement relatif au PIB – les pics de la fin des années 90, notamment dans les télécommunications. La situation demeure inquiétante : aucun signe de ralentissement n’est encore visible. Comme le rappelaient des études de 2015 de Jorda, Schularick et Taylor, une bulle ne devient une crise que lorsque le crédit bancaire y est fortement associé. Cette combinaison explosive semble être à nouveau en train de se mettre en place.
La question critique tourne désormais autour de la provenance des fonds soutenant cette expansion. Si ce flux venait à se tarir, qui récupérerait alors les actifs ? La logique économique actuelle, celle du « tant que la musique joue, il faut continuer à danser », rappelle tragiquement le contexte précédant 2008. Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a publiquement averti que le crédit privé pourrait constituer le « point chaud » de la prochaine crise financière, même si la banque qu’il dirige accroît elle-même ses activités dans ce secteur.
En somme, alors que les géants du numérique bâtissent des centres de données à un rythme jamais vu et que l’IA promet de transformer notre monde, une partie du système financier s’est dangereusement endettée sur cette promesse d’un futur inéluctable. Si la bulle se dégonfle, le coût ne serait pas réservé aux investisseurs de Silicon Valley, mais pourrait entraîner une crise financière mondiale.
Comme le souligne une réflexion récente, “le problème ne réside pas dans la surconstruction, mais dans la manière dont cet excès est financé. En 2025, la réponse est de plus en plus hors de portée du grand public.”