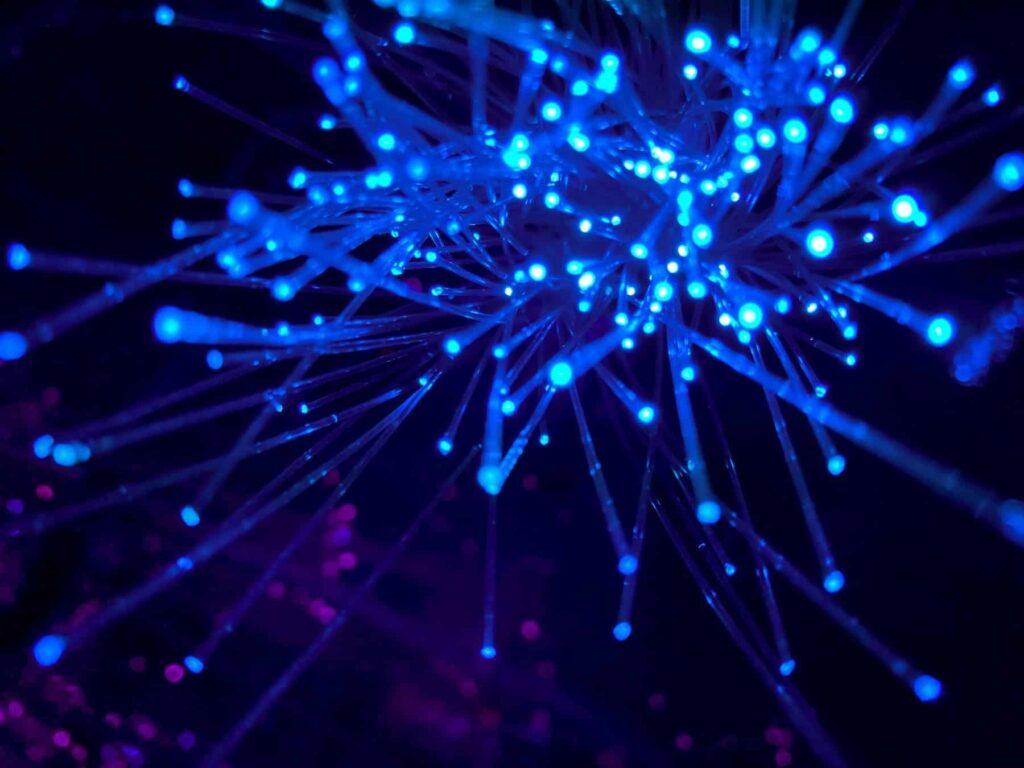L’économie numérique repose sur deux forces indissociables : capacité et interconnexion. D’un côté, les entreprises, hyperscalers et fournisseurs de cloud ont besoin de méga watts et de mètres carrés pour héberger des charges en croissance exponentielle — intelligence artificielle, cloud native, analytique en temps réel —. De l’autre, elles dépendent d’écosystèmes denses de opérateurs, IXPs, nuages, câbles sous-marins et partenaires qui transmettent les données à la vitesse des affaires. Considérer ces éléments comme des priorités opposées constitue une erreur courante : sans capacité, pas d’échelle ; sans interconnexion, pas de performance.
Les hôtels de carriers les plus emblématiques au monde — de 60 Hudson Street (New York) à 350 East Cermak (Chicago) ou 1 Wilshire (Los Angeles) — ont acquis ce statut parce qu’ils mais sont à la fois. Et cet équilibre reconfigure aujourd’hui la carte européenne, avec Madrid qui grimpe dans la course mondiale des centres de données.
“La réalité opérationnelle nous le rappelle chaque jour : le centre de données disposant uniquement de méga watts est un entrepôt coûteux, et celui qui ne possède que des fibres et des IXPs est un cul-de-sac. La valeur réside dans croiser capacité et interconnexion dans le même écosystème,” souligne David Carrero, cofondateur de Stackscale (groupe Aire), fournisseur européen de cloud privé et bare-metal qui collabore avec des centres de données de référence sur le continent (Stackscale ne construit ni n’opère de centres de données ; il fournit des services dessus).
Interconnexion : le pouls de l’infrastructure
L’interconnexion transforme un bâtiment abritant des serveurs en un marché vivant de connectivité. Les entreprises ne louent pas seulement de l’espace et de la puissance ; elles se tournent vers les hôtels de carriers pour bénéficier de l’écosystème qu’ils hébergent :
- Faible latence : les cross-connects et le peering direct évitent les itinéraires publics congestionnés.
- Efficience des coûts : le peering et les fabrics réduisent la dépendance à un transit IP coûteux.
- Résilience : multiples carriers et itinséraires — souvent appuyés par des câbles sous-marins — offrent une redondance physique.
- Couverture : une simple connexion à des partenaires déjà présents dans le bâtiment suffit pour ouvrir des marchés en quelques heures, et non des mois.
En Amérique du Nord, des opérateurs tels que Digital Realty et Equinix ont transformé leurs bâtiments phares en aimants à carriers, points d’accès au cloud et systèmes sous-marins. Ils ont étendu cette valeur avec des fabrics neutres au niveau applicatif permettant virtualisation des interconnexions entre géographies et fournisseurs.
Capacité : la base pour une croissance véritable
Alors que l’interconnexion stimule la performance, la capacité soutient la croissance. Un hôtel de carriers moderne doit offrir les deux :
- Densité de puissance pour IA, HPC et charges cloud exigeantes (aujourd’hui, 50–80 kW par rack n’est plus exceptionnel).
- Évolutivité : croître sans quitter l’écosystème (même campus, même maillage de cross-connects).
- Résilience : alimentation A/B, refroidissement liquide en cas de besoin, maintenance sans interruption de service.
Depuis des années, 350 East Cermak (Chicago) ou 56 Marietta (Atlanta) ont associé capacité et interconnexion sous un même toit. Aujourd’hui, même les géants du cloud qui louent des dizaines de MW dans de nouveaux développements cherchent à ancrer une partie de leur présence dans des hubs d’interconnexion : sans écosystème, la capacité perd de sa valeur stratégique.
La gravité des données : les données attirent applications, réseaux et partenaires
Le concept de Data Gravity a révolutionné la déploiement des technologies de l’information. Autrefois centralisés en on-premise, les données croissent désormais exponentiellement dans les nuages, edge et environnements hybrides. Au fur et à mesure qu’elles augmentent, elles attirent autour d’elles des applications, services et analyses. En pratique, l’endroit où résident les données détermine où doit vivre l’écosystème.
Exemples classiques en États-Unis :
- 60 Hudson (New York) héberge des traders et des fournisseurs de low-latency non seulement pour sa capacité, mais aussi pour la concentration de brokers, feeds et opérateurs dans la même station.
- 1 Wilshire (Los Angeles) relie contenu et CDN à l’Asie-Pacifique via sa fenêtre sous-marine.
- Westin Building Exchange (Seattle) sert de point d’ancrage pour les câbles transpacifiques alimentant le nord-ouest.
Ce modèle est transférable en Europe.
Europe en première ligne : de FLAP-D à Madrid, Marseille et au-delà
Le paysage européen était dominé par FLAP-D — Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin —. D’ici 2025, cette cartographie s’élargira pour une raison simple : puissance électrique disponible. Avec des crédits ou moratoires électriques dans certains hubs, la capacité et l’interconnexion ont connu une croissance dans des villes capables d’offrir à la fois méga watts et fibre optique centrale. Parmi elles :
- Madrid. Est passée d’alternative à hub principal : capacité électrique avec possibilité d’extension, peering via IXPs (DE-CIX Madrid, ESpanix), routes backbone et proximité avec les câbles sous-marins qui atterrissent à Bilbao (MAREA, Grace Hopper), Barcelone (2Africa) ou Valence/Cartagène (nouveaux systèmes en déploiement). La capitale espagnole offre faible latence vers la péninsule ibérique, le sud de la France, l’Afrique du Nord et de bonnes routes vers les hubs européens centraux.
- Marseille. Est devenue la grande porte méditerranéenne vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. Son écosystème s’est étoffé avec des systèmes sous-marins convergeant en Provence.
- Lisbonne / Sines. Le câble EllaLink et de nouveaux projets transforment la façade atlantique portugaise en point d’ancrage pour flows européens–Amérique latine, avec des coûts et une énergie compétitifs.
- Milan/Turin. Le nord de l’Italie concentre industrie, peering régional et connectivité intra-européenne.
- Varsovie. Nœud de l’Europe de l’Est, elle gagne en importance grâce à la géopolitique et à l’expansion vers les pays baltes.
- Zürich et Vienne/Bratislava. Options attrayantes pour leur stabilité, énergie et liens transfrontaliers.
“Madrid se distingue en combinant méga watts et écosystème. En associant DE-CIX/ESpanix, la proximité avec les câbles, la faible latence vers l’Iberia et de solides routes vers l’Europe centrale, on dispose du terrain fertile pour l’IA et le bare-metal haute performance,” indique Carrero.
Les « hôtels de carriers » européens : où bat le peering
L’Europe dispose de bâtiments emblématiques d’interconnexion qui, à l’instar de leurs homologues américains, mêlent écosystèmes et échelle :
- Telehouse Docklands (Londres) et Harbour Exchange concentrent peering (LINX) et on-ramps cloud.
- Complexes d’Interxion/Digital Realty et Equinix à Francfort — avec DE-CIX comme aimant — sont des références du centre de l’Europe.
- Voltaire / TH2 (Paris) et les campus en périphérie concentrent le transit à l’échelle du continent.
- AMS-IX (Amsterdam) et ses data centers du Science Park maintiennent leur rôle historique.
- MRS1-3 (Marseille), la porte méditerranéenne des câbles.
- Madrid se développe autour de campus à Alcobendas, San Fernando, Valdebebas et en périphérie, connectés à des IXPs et des backbones nationaux et internationaux.
Le principe est connu : hôtel de carriers + campus d’échelle dans la même métro. Le premier opère comme marché; le second, comme réservoir de mégawatts. Sans ponts (physiques ou virtuels) entre les deux, l’équation ne fonctionne pas.
Sous-marin : la “gravité” qui traverse les océans
On estime que >95 % du trafic international transite par câbles sous-marins. En Europe, ce maillage explique pourquoi Marseille et ses littoraux atlantiques (Bilbao à Sines) se développent en interconnexion. Pour les entreprises, déployer en mètres avec des fenêtres sous-marines et des IXPs actifs réduit la latence, diminue les coûts de transit, et ouvre des audiences vers d’autres régions.
Opposition ou convergence ? La synthèse “capacité vs interconnexion” n’est plus d’actualité
En 2025, il ne s’agit plus de choisir entre capacité et interconnexion, mais de convergence. L’IA, l’edge et l’adoption globale du cloud exigent une infrastructure capable de faire évoluer les charges tout en connectant instantanément au monde. La stratégie gagnante marie :
- Capacité : campus évolutifs, haute densité de puissance, refroidissement liquide pour héberger des pods de 60–80 kW/rack, ou des fases de dizaines de MW.
- Interconnexion : câbles physiques (IXPs, carriers, on-ramps cloud, sous-marins) et virtuels (fabrics neutres) pour faire circuler les données à des latences prévisibles et des coûts optimisés.
Amérique du Nord et Europe : deux faces d’une même pièce
Le schéma classique liste les hôtels de carriers nord-américains — 60 Hudson, 1 Wilshire, Westin, 350 E. Cermak, 56 Marietta, 11 Great Oaks, 32 Avenue of the Americas — et leurs opérateurs respectifs : Digital Realty, Equinix, CoreSite, Cologix. En Europe, on retrouve des équivalents — Docklands, FRA, PAR, AMS, MRS, MAD — avec des fournisseurs à empreinte mondiale reproduisant le même modèle : forte densité d’interconnexion dans le métro central et capacité évolutive dans les campus alentours.
Ce qui diffère en 2025, c’est que la demande d’IA a élevé la barre de la capacité, et la pénurie électrique dans certains hubs a déplacé la Data Gravity vers des métros émergents : c’est ici que s’intègrent Madrid, Lisbonne / Sines, Varsovie, ou Turin/Milan. La règle de l’interconnexion reste la même : où résident les données, se concentrent carriers, clouds et partenaires.
Comment décider : quatre critères pratiques à suivre (et une erreur à éviter)
1) Écosystème existant. Y a-t-il carriers, IXPs et on-ramps dans le bâtiment ? Quels cross-connects et meet-me rooms sont proposés ? Y a-t-il des fabrics pour étendre l’interconnexion virtuellement à d’autres métros ?
2) Sous-marin et itinéraires. Accès à câbles avec faible latence vers vos marchés ? Diversité dans les routes et niveaux de SLA ?
3) Capacité réelle. Le fournisseur peut-il dupliquer ou tripler la capacité dans le même métro sans migrations difficiles ? Dispose-t-il d’un pipeline de puissance et d’espace ?
4) Densité et efficacité. Supporte-t-il liquide (D2C ou immersif), 415 V, 80 kW/rack ? Mesure-t-il et publie-t-il le PUE/TUE et l’utilisation des énergies renouvelables ?
L’erreur : se concentrer uniquement sur la capacité dans un environnement sans connectivité ou uniquement sur l’interconnexion sans méga watts. La Data Gravity pénalise ces deux extrêmes.
Cas d’étude Madrid : faible latence vers le sud de l’Europe et plateforme atlantico-méditerranéenne
Madrid a conquis une place centrale en Europe grâce à sa intersection : capacité à héberger des pods GPU haute densité et un écosystème de connectivité vers des IXPs et câbles sous-marins atlantique (Bilbao) et méditerranéen (Barcelone / Valence). Particulièrement pour l’IA :
- Formation en campus avec électrique liquidée et 415 V ;
- Inférence à basse latence vers Iberia, sud de la France et nord de l’Afrique ;
- Reprise et disaster recovery vers d’autres hubs européens, avec routes variées.
“Pour les clients souhaitant déployer l’IA dès maintenant en Europe, Madrid offre un mix incomparable : méga watts, écosystème et latence. En intégrant PPA renouvelables et efficacité (pods liquidés, câblés), le coût par résultat — et non par heure — devient compétitif,” indique Carrero.
Ce que les entreprises doivent exiger en 2025
- Visibilité électrique : capacité signée, dates et prolongations ;
- Engagement ESG authentiques : PPAs, gestion de l’eau, reporting ;
- Fabrics permettant une interconnexion virtuelle métro à métro et multicloud sans dépendance au transit public ;
- Options d’expansion dans un délai de 24 à 36 mois (sol, MW, m²) dans le même métro ;
- Outils pour observabilité : latences, cross-connects, ports, coûts/transit, et FinOps.
Conclusion : le paysage reste le même, la répartition a changé
Capacité construit le scénario ; l’interconnexion en réalise la performance. En 2025, il ne s’agit pas de choisir, mais de équilibrer. Les hôtels de carriers et les campus qui combinent le mieux ces deux axes — à New York, Chicago, Los Angeles… ainsi qu’en Madrid, Marseille, Londres ou Francfort — seront les pôles d’une Data Gravity sans frontières. Les entreprises déployant là où l’écosystème est déjà en place, avec des méga watts garantis et routes diversifiées, gagneront en réduction de latence, en coûts et surtout en temps.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un carrier hotel et comment se différencie-t-il d’un centre de données traditionnel ?
Un carrier hotel est un bâtiment d’interconnexion avec une très haute densité de carriers, IXPs, on-ramps cloud et partenaires, en plus de capacité (puissance et espace). Il offre une faible latence, une résilience (routes multiples) et un accès immédiat à des écosystèmes déjà présents ; un centre de données classique peut disposer de puissance, mais pas du même marché de connectivité.
Pourquoi Madrid est-elle devenue un hub européen d’interconnexion et de capacité ?
Parce que elle combine capacité électrique évolutive, IXPs actifs (DE-CIX Madrid, ESpanix), routes backbone et proximité des câbles sous-marins atlantiques et méditerranéens. Cela facilite l’entraînement et l’inférence en IA avec une latence faible vers l Iberia et la connexion à l’Europe et à l’Afrique du Nord avec des routes diverses.
Qu’est-ce que la Data Gravity dans les centres de données et pourquoi est-ce important ?
La Data Gravity désigne la tendance des données à attirer applications, réseaux et partenaires qui gravitent autour. Où résident les données, convergent réseaux, cloud et partenaires. Déployer dans des écosystèmes connectés permet de réduire la latence et les coûts et d’accélérer l’innovation.
Interconnexion vs capacité : sur quoi prioriser pour un projet neuf ?
Ce n’est pas une alternative. Évaluez l’écosystème existant (carriers, IXPs, on-ramps), l’accès aux câbles (sous-marins) et fabrics virtuels, ainsi que la capacité (MW, densité par rack) et l’expansion (24-36 mois). Se concentrer uniquement sur la capacité ou uniquement sur l’interconnexion peut entraîner des surcoûts et ralentir l’activité.