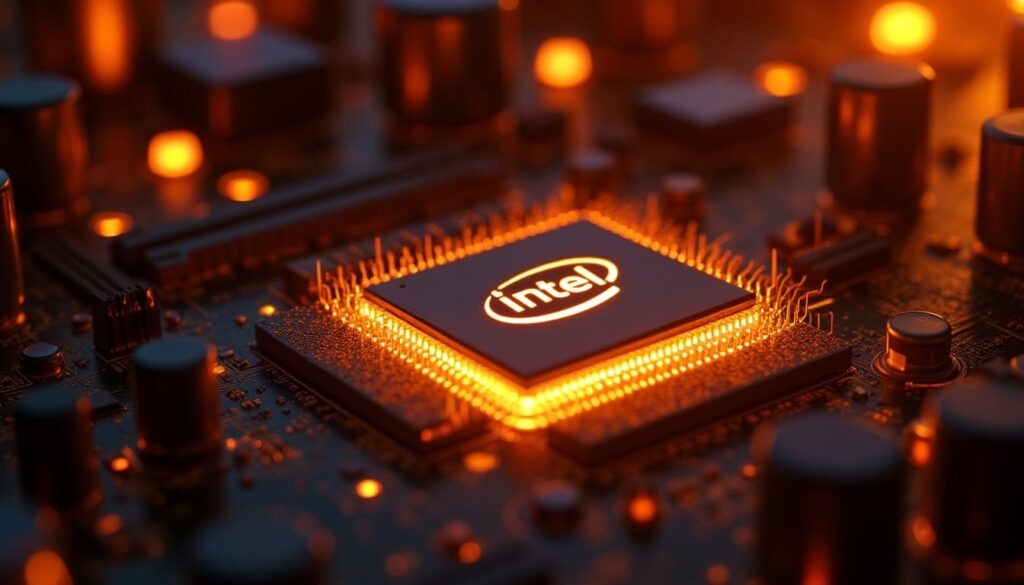Intel annonce un accord inédit avec l’administration Trump, redéfinissant la relation entre le gouvernement américain et l’un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs. La région de Washington investira 8,9 milliards de dollars en actions ordinaires d’Intel, lui assurant une participation de 9,9 % dans l’entreprise et consolidant sa stratégie de rapatriement de la production technologique critique.
Cette opération, qualifiée de « étape décisive pour le leadership technologique des États-Unis », s’ajoute aux investissements déjà engagés dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act et du programme Secure Enclave, portant le soutien total à 11,1 milliards de dollars.
L’accord porte un impact géopolitique et économique majeur, notamment dans un contexte où l’industrie des semi-conducteurs devient un levier de tensions entre les États-Unis et la Chine. L’administration Trump cherche à réduire la dépendance de l’Asie dans la fabrication de puces avancées et à renforcer la chaîne d’approvisionnement face à d’éventuelles crises futures. Lip-Bu Tan, le CEO actuel d’Intel, a résumé cette ambition en affirmant : « En tant que seule entreprise combinant R&D et fabrication de logique avancée aux États-Unis, nous sommes profondément engagés pour que les technologies de pointe soient « made in USA. »
Le département du Commerce a également souligné que cet investissement renforcera la sécurité nationale tout en stimulant la compétitivité de l’industrie américaine dans l’intelligence artificielle et le calcul haute performance. La gouvernance de l’entreprise restera inchangée : le gouvernement achètera 433,3 millions d’actions à 20,47 dollars chacune, à un prix inférieur à la valeur de marché, lui conférant une participation stratégique favorable. Une option d’achat supplémentaire à cinq ans permettra au gouvernement d’acquérir un 5 % supplémentaire si Intel perdait le contrôle majoritaire de ses activités de fonderie.
Pour renforcer la confiance des marchés, l’administration s’engage à ne pas intervenir dans la gestion ou la gouvernance d’Intel, votant selon les recommandations de la direction. Par ailleurs, Intel a consacré 108 milliards de dollars ces cinq dernières années à l’investissement en capital et 79 milliards à la R&D, principalement en vue d’étendre ses capacités de fabrication aux États-Unis. La nouvelle usine clé en Arizona, dont la mise en production est prévue pour fin 2025, illustrera cette expansion avec la technologie la plus avancée jamais déployée dans le pays.
L’annonce a suscité de nombreux soutiens dans le secteur technologique : Satya Nadella de Microsoft a indiqué que cette alliance renforçait l’innovation américaine. Michael Dell de Dell Technologies a souligné l’importance d’une industrie robuste et résiliente. Enrique Lores, CEO de HP, a insisté sur la nécessité de la production domestique pour assurer l’innovation et la sécurité numériques. Et chez AWS, Matt Garman a évoqué les semi-conducteurs comme la clé de l’intelligence artificielle.
Ce partenariat stratégique intervient également dans un contexte où Intel, sous la direction de Lip-Bu Tan depuis mars, cherche à retrouver sa position de leader face à des concurrents tels que TSMC, Samsung ou NVIDIA. Il donne à l’entreprise les moyens financiers de revitaliser sa culture d’ingénierie, d’augmenter sa production nationale et de devenir un partenaire clé pour la cloud et l’intelligence artificielle.
Cependant, cette alliance suscite également des interrogations. La compétition féroce dans le secteur, la haute technicité des enjeux et la présence du gouvernement comme actionnaire soulèvent des questions sur l’autonomie de l’entreprise. La situation géopolitique tendue, notamment avec la Chine, la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, accentue ce contexte incertain.
En définitive, cet accord marque un tournant historique dans la relation entre le secteur privé et l’État américain, symbolisant une volonté de souveraineté technologique. Reste à voir si cette opération permettra à Intel de recoller au sommet, tout en renforçant la position dominante des États-Unis dans la course mondiale aux semi-conducteurs.