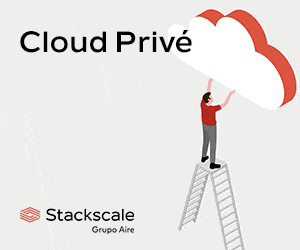La lutte pour la souveraineté numérique en Europe vient de gagner un acteur de poids dans le débat. Google, par l’intermédiaire de son principal responsable juridique et des affaires mondiales, Kent Walker, a mis en garde l’Union européenne contre une approche trop restrictive — axée sur la réduction de la dépendance technologique extérieure en érigeant des barrières — qui pourrait finir par être « contre-productive ». Ce message intervient alors que Bruxelles prépare un paquet de mesures de « souveraineté technologique » prévu pour le printemps 2026 et que, parallèlement, plusieurs institutions publiques européennes accélèrent leur transition vers des alternatives locales et open source.
Cette déclaration a été faite lors d’une interview publiée le 13 février 2026, où Walker décrivait une « paradoxe compétitive » : l’Europe souhaite stimuler la croissance et la productivité, mais risque de limiter l’accès aux technologies de pointe qui pourraient justement aider à atteindre ces objectifs. Dans son argumentaire, il ne s’agit pas que la UE cherche davantage de contrôle et de résilience, mais plutôt d’une interprétation de cette souveraineté comme une fermeture aux fournisseurs et outils mondiaux.
Souveraineté numérique : de la régulation à l’infrastructure (et au logiciel)
L’Union européenne renforce depuis plusieurs années son rôle régulateur dans l’écosystème numérique. Des normes telles que la DMA (Digital Markets Act) et la DSA (Digital Services Act) ont durci les exigences en matière de transparence, de concurrence et de responsabilité des grandes plateformes. Mais le débat de 2026 va au-delà de la simple régulation : il touche à l’architecture même de l’économie numérique européenne, de la gouvernance du cloud et des données jusqu’au logiciel utilisé par les administrations et les secteurs dits critiques.
Au fond, la question est double. D’un côté, la dépendance : si des services essentiels reposent sur des fournisseurs extérieurs, il existe la crainte d’interruptions, de pressions politiques ou de changements contractuels hors du contrôle européen. De l’autre, l’industrie : si l’Europe veut développer des champions technologiques locaux, elle doit favoriser la demande intérieure, renforcer ses capacités, et bâtir un écosystème plus durable.
Cette tension s’est accentuée ces derniers mois à cause du contexte géopolitique et de la crainte d’une « déconnexion technologique » transatlantique. Parallèlement, on voit apparaître des initiatives concrètes, avec des administrations qui remplacent des outils commerciaux américains par des alternatives européennes ou open source, en mettant en avant la sécurité et la protection des données.
L’argument économique en faveur du logiciel libre (avec chiffres à l’appui)
La volonté européenne de favoriser le logiciel libre ne s’appuie pas uniquement sur une logique politique ou culturelle. La Commission européenne a explicitement souligné l’impact économique de l’open source : une étude commandée par l’UE estime que les entreprises de l’Union ont investi environ 1 milliard d’euros dans le logiciel open source en 2018, avec un impact positif compris entre 65 et 95 milliards d’euros sur l’économie européenne. La même étude indique qu’augmenter de 10 % les contributions au code open source pourrait générer entre 0,4 % et 0,6 % de croissance du PIB annuel, ainsi que plus de 600 nouvelles start-ups dans le secteur TIC en UE.
Dans ce contexte, Bruxelles ne se contente pas de parler « d’utiliser des logiciels locaux » : elle insiste aussi sur la nécessité d’éviter le vendor lock-in (dépendance vis-à-vis d’un fournisseur), de réduire le coût total de possession dans le secteur public, et de renforcer l’autonomie dans les composants numériques clés. Il s’agit d’une souveraineté qui ne se limite pas à l’achat « européen », mais qui consiste à pouvoir auditer, contrôler et modifier ses outils sans rester piégé.
La réponse de Google : « souveraineté ouverte » et alliances hybrides
Google ne remet pas en question le désir de l’Europe d’accroître son contrôle. En revanche, son désaccord porte sur la manière. Walker propose un concept que la société qualifie de « souveraineté numérique ouverte » : un modèle hybride combinant contrôle local sur les données, conformité réglementaire et exploitation tout en continuant à utiliser des technologies mondiales quand cela s’avère nécessaire.
Selon ses déclarations, cette formule implique des alliances entre entreprises américaines et européennes, afin que le stockage et la gestion des données puissent être régis par des règles européennes — y compris la localisation géographique si pertinent — sans renoncer aux technologies considérées comme de pointe, notamment avec l’accélération de l’intelligence artificielle. Walker affirme également que « ériger des murs » empêchant l’accès à « la meilleure technologie du monde » pourrait finir par nuire aux entreprises et aux consommateurs européens.
Ce point n’est pas anodin : si le cadre de souveraineté se traduit concrètement par des interdictions ou une substitution rapide et rigide des technologies, la transition pourrait devenir plus coûteuse, plus longue et moins compétitive. Google se montre aussi fier de rappeler sa présence en Europe : Walker a affirmé que la société est présente depuis plus de 25 ans sur le continent, avec plus de 30 000 employés répartis dans 42 bureaux.
Le débat s’ouvre : « autonomie totale » vs « autonomie par couches »
Ce débat ne concerne pas seulement Google. En parallèle, des voix du secteur technologique européen nuancent l’idée d’une « souveraineté totale ». Aiman Ezzat, PDG de Capgemini, a rejeté cette idée et précisé qu’aucun pays ne contrôle l’intégralité de la chaîne de valeur nécessaire pour offrir des services numériques complets. Il propose d’envisager l’autonomie comme un ensemble de couches — données, opérations, régulation et technologie — dans lesquelles l’Europe peut être plus forte sur certains domaines et élaborer des stratégies adaptées à chaque cas d’usage.
Ce mode de pensée « par couches » rejoint une réalité difficile : même lorsqu’on opte pour des logiciels libres, une grande partie du marché dépend encore d’infrastructures, de puces, de services cloud, de chaînes d’approvisionnement, et d’écosystèmes de développeurs mondiaux. En 2026, la souveraineté ressemble moins à un interrupteur (oui/non) et plus à un tableau de bord avec différents degrés d’indépendance.
Et maintenant ? La souveraineté numérique entre dans sa phase la plus concrète
Le printemps 2026 marquera une étape décisive, car l’UE devra concrétiser son « paquet de souveraineté technologique » en décisions opérationnelles : exigences, certifications, achats publics, cloud souverain, normes d’interopérabilité, critères pour les infrastructures critiques.
Si Bruxelles privilégie le logiciel libre, elle devra aussi relever un autre défi majeur : financement et durabilité. Le code open source peut être « libre » en licence, mais sa maintenance, ses audits, sa sécurisation ne sont pas gratuits. La Commission européenne a déjà souligné que sa stratégie consiste à encourager la réutilisation, le partage de solutions, et à renforcer l’open source dans ses politiques futures. Sur ce terrain, le débat dépasse la simple idéologie : il est aussi industriel, budgétaire et sécuritaire.
Au centre de cette dynamique, Google cherche à promouvoir une idée d’équilibre : la souveraineté, oui, mais sans s’isoler. L’Europe, pour sa part, tente d’éviter que la dépendance devienne une vulnérabilité. Enfin, les entreprises — des PME aux grands opérateurs — scrutent le tableau avec une question simple : quel modèle leur offrira plus de certitude, moins de risques et une meilleure capacité d’innovation ?
Questions fréquentes
Que signifie « souveraineté numérique ouverte » selon Google ?
Il s’agit d’une approche hybride visant à maintenir un contrôle local sur les données et la conformité réglementaire en Europe, tout en permettant l’accès aux technologies mondiales si nécessaire. La stratégie repose sur des alliances entre entreprises européennes et américaines pour combiner contrôle local et innovation accessible.
D’où vient le chiffre de 65 à 95 milliards d’euros associé au logiciel libre ?
Il provient d’une étude publiée par la Commission européenne sur l’impact économique du logiciel et du matériel open source en Europe, qui estime cette contribution annuelle entre ces deux montants en tenant compte des investissements et de la réutilisation.
Une migration massive vers le logiciel libre peut-elle améliorer la cybersécurité ?
Cela dépend des cas. Le logiciel open source facilite l’audit et la transparence, mais la sécurité effective nécessite un maintien continu, des patches rapides, une revue des dépendances, et des équipes capables d’opérer et de surveiller les systèmes. Sans financement ni gouvernance solide, le risque persiste.
Quels secteurs européens pourraient être les plus impactés par les décisions en matière de souveraineté numérique ?
Particulièrement ceux qui gèrent des infrastructures critiques ou des données sensibles : administrations, santé, énergie, télécommunications, défense, banque, et les grandes plateformes dépendantes du cloud, de la collaboration, et des outils de productivité à grande échelle.